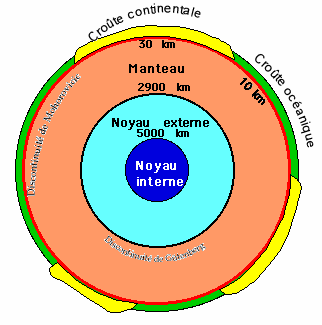 Figure 2: structure interne du globe terrestre
Figure 2: structure interne du globe terrestre
L'eau est présente:
* dans corps d'eau superficiels (océans, lacs, rivières) et souterrains (nappe) = hydrosphère
* dans les roches de l'écorce et du manteau: dans les interstices ou dans la composition chimique des minéraux.
L'EAU DE L'ECORCE
L'eau des sols
Les sols sont des réservoirs d'eau; l'eau est contenue dans certains minéraux, en particulier les minéraux argileux, et dans la matière organique; celle-ci forme notamment des complexes organo-minéraux mal cristallisés qui retiennent l'eau. L'eau des argiles peut être simplement adsorbée à la surface des cristaux; cette eau est mobile et en grande partie disponible pour les plantes (réserve utile). Il y a en plus de l'eau entrant dans la constitution même des minéraux qui ne peut être extraite que par élévation de température au dessus de 100 °C et qui n'est donc pas disponible pour les êtres vivants.
L'eau du sol provient des précipitations atmosphériques. Elle est transférée vers l'atmosphère par évaporation directe et par transpiration des plantes ainsi que vers les réservoirs profonds par infiltration. Le bilan hydrique du sol est déterminant pour l'agriculture.
L'eau des roches
Dans les roches, l'eau remplit les espaces vides: fissures, pores. Elle entre également dans la constitution des minéraux.
Dans les roches magmatiques formées en profondeur (roches plutoniques comme le granite par exemple), il n'y a pas de pores entre les grains; l'eau remplit des fissures de taille variable (diaclases). Lorsque la fracturation est dense, le réseau de fissures peut emmagasiner suffisamment d'eau pour donner un véritable aquifère. L'eau entrant dans la constitution des minéraux est plus discrète: dans ce type de roches, les minéraux ne sont que faiblement hydratés (micas en particulier). L'altération des minéraux par hydrolyse correspond à un enrichissement de la roche en eau.
Les roches sédimentaires, formées à la surface, sont plus riches en eau. Les minéraux sont plus hydratés (en particulier les minéraux argileux) mais surtout les espaces vides sont généralement nombreux: la roche est poreuse. Lorsque ces pores communiquent, la roche est perméable à l'eau. La roche imbibée d'eau constitue un aquifère (par exemple la nappe des sables verts dans le Bassin de Paris). Cette eau interstitielle provient de l'infiltration superficielle. Elle peut avoir une origine plus ancienne, lorsqu'elle a été emprisonnée dans les pores au dépôt des sédiments: cette eau contemporaine du dépôt est dite connée.
Lorsque les roches sédimentaires sont entraînées en profondeur, elles sont soumises à des températures et des pressions plus élevées. Elles subissent des transformations physiques et minéralogiques entrant dans le cadre de la diagénèse. Elles perdent notamment une partie de leur eau intertititielle par diminution des pores sous l'effet de la pression et du dépôt de ciment (diminution de la porosité). L'eau de constitution des minéraux hydratés peut également s'échapper tandis que se forment de nouveaux minéraux stables dans les nouvelles conditions physico-chimiques (pour les minéraux argileux, transformation des smectites en illites puis en micas). Les modifications diagénétiques diminuent donc la porosité de la roche, mais à partir d'une certaine profondeur, plusieurs milliers de mètres, d'autres transformations minéralogiques produisent des vides entre les grains: il apparaît alors une porosité secondaire. Les eaux intertitielles sont riches en ions dissous; elles peuvent éventuellement remonter à la surface et donner des sources fortement minéralisées.
Lorsque les cristallisations sont importantes sous l'effet de la température et de la pression, la roche devient une roche métamorphique, dont les propriétés se rapprochent des roches plutoniques: elle perd son eau intertitielle et une grande partie de l'eau de constitution de ses minéraux.
L'EAU DU MANTEAU
Le manteau est une grande enveloppe rocheuse qui s'étend entre 30 et 2900 km de profondeur et représente à peu près les 2/3 de la masse de la Terre. Le manteau remonte à la surface au niveau des dorsales médio-océanique et expulse de l'eau et des laves basaltiques qui refroidissent et forme la croûte océanique. L'eau de mer altère les roches de la croûte océanique et produit des minéraux hydratés: une fraction de l'eau de la surface est donc incorporée dans la croûte altérée. Cette croûte enrichie en eau repart dans le manteau au niveau des grandes fosses de subduction.
Le volcanisme des îles océaniques (points chauds) et celui des rifts continentaux émet également de l'eau à partir du manteau.
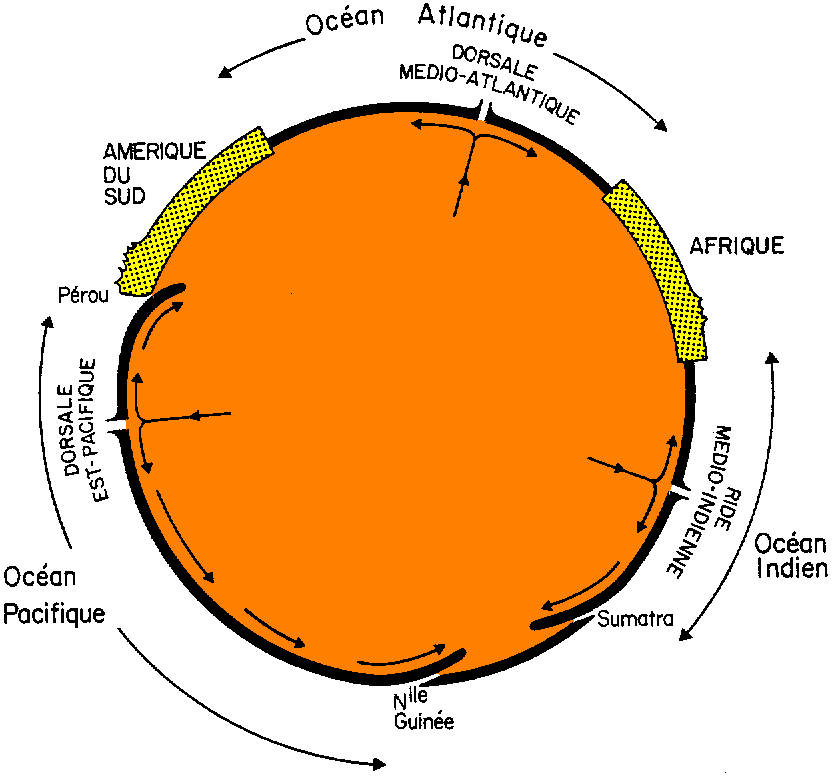
Figure 4: génération et résorption de la croûte océanique (en noir)
Le manteau contient et apporte donc de l'eau à la surface. Il s'agit de connaître la quantité d'eau totale stockée dans le manteau, la forme sous laquelle elle existe, les mécanismes de transfert, le bilan des échanges d'eau avec la surface et l'impact de ce cycle interne sur le cycle de l'eau traditionnel.
La présence d'eau dans le manteau est attestée par la teneur des produits volcaniques issus du manteau. Les laves basaltiques émises au fond des océans contiennent de 0,10 à 0,45% d'eau; les basaltes des îles océaniques, comme les îles Hawaï, et les basaltes de plateau, comme ceux des Trappes du Dekkan, qui proviennent de la différenciation du manteau profond (point chaud) en contiennent 0,2 à 0,6%. Des fragments de péridotites sont remontés par les volcans; elles proviennent de régions du manteau situées jusqu'à 300 km de profondeur. Ces péridotites contiennent des traces d'eau de l'ordre de 100 à 1000 ppm.
La quantité totale d'eau contenue dans le manteau est difficiles à évaluer: il est certain qu'une partie au moins du manteau est hydratée. En supposant que seule la partie externe du manteau, située entre -30 et -670 km, contient de l'eau à une teneur comprise entre 100 et 1000 ppm, on arrive à une masse d'eau comprise entre 10 20et 10 21 kg . Pour mémoire , le contenu actuel des océans est évalué à 1,4 10 21 kg.
Des travaux expérimentaux récents montrent que les minéraux du manteau sous l'effet de la pression peuvent contenir beaucoup plus d'eau qu'on le pensait, plusieurs fois la masse de l'hydrosphère. Néanmoins, le bilan des échanges d'eau entre la surface et la profondeur paraît remarquablement équilibré puisque le volume total des mers semble avoir peu varier depuis plusieurs centaines de millions d'années.
Le bilan des échanges d'eau entre la surface et la profondeur est difficile à quantifier.
Les apports du manteau se font d'abord par le volcanisme des dorsales océaniques: l'eau contenue dans les péridotites du manteau est extraite au moment de leur fusion partielle. Elle est ensuite transportée vers la surface par les magmas basaltiques ou dégagée en fumerolles sous pression (fumeurs) richement minéralisées. En prenant une teneur moyenne en eau de 0,15 à 0,45% pour la croûte océanique nouvellement formée, on aboutit à un apport annuel de 0,8 1011 à 2,40 1011 kg d'eau. Cette croûte océanique s'enrichie en eau au contact de l'eau de mer, elle est recouverte de sédiments gorgés d'eau puis elle est finalement absorbée dans les zones de subduction. Une partie de l'eau de la croûte est ainsi réinjectée dans le manteau, qui est estimée à 5 à 16 1011 kg par an.
Les volcans apportent également de l'eau du manteau sous forme de vapeur. Les phases éruptions sont généralement accompagnées de fortes précipitations. Cette eau peut être d'origine profonde, comme c'est en général le cas pour les volcans des points chauds. Ce peut être également de l'eau superficielle qui s'est infiltrée, s'est réchauffée en profondeur pour remonter enfin par thermosiphon. Les geysers sont souvent de ce type.
L'examen des enregistrements sédimentaires montre que le volume d'eau contenue dans les océans a peu varié depuis le dernier milliard d'années. Depuis un milliard d'années, le cycle de l'eau est à l'état stationnaire et la quantité d'eau réintroduite dans le manteau est compensée par celle qui sort des dorsales. Bien qu'il y ait constamment échanges d'eau entre le manteau et la surface, avec des vitesses de transfert très lents et des temps de résidence atteignant plusieurs centaines de millions d'années, le stock d'eau disponible sur la Terre peut être considéré comme constant.